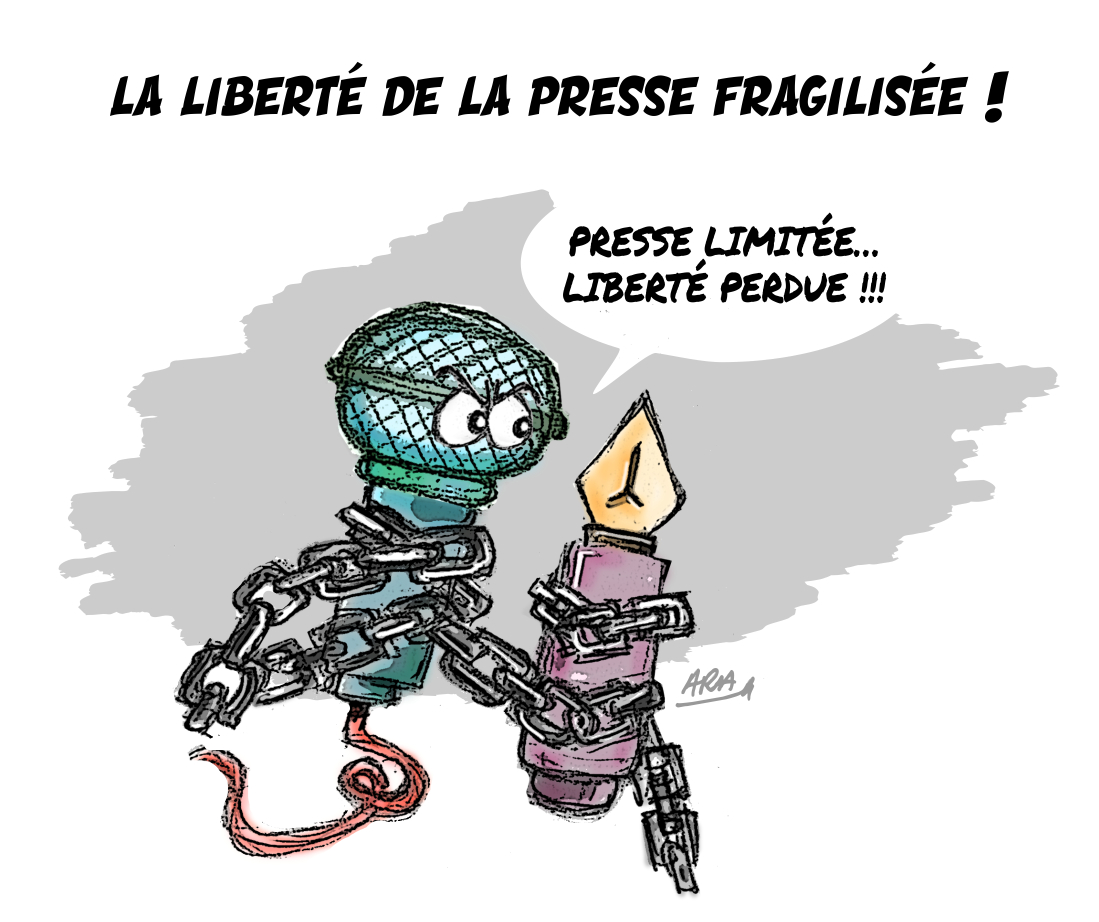Le Conseil d'État et les vaccins : l’ange gardien d’une politique iatrogène à caractère criminel ?

TRIBUNE - « Que les empires, sans la justice, ne sont que des ramassis de brigands. » Saint Augustin (354-430).
En France, l’un des garants de cette « justice » est le Conseil d’État (CE). Cette haute juridiction est le juge de l’administration dont fait partie notamment l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM), la Haute autorité de santé (HAS), les services ministériels, etc. Il est aussi le conseiller du gouvernement. Le Conseil d’État est né de la Constitution du 22 frimaire an VIII (15 décembre 1799). En réalité, il n’est que le prolongement du Conseil d’État du roi qui était en action depuis des siècles. Sous l’Ancien régime, il était l’un des instruments qui conférait au pouvoir monarchique toute sa puissance. Ce pouvoir du roi était ainsi à l’abri de toute intervention d’une juridiction indépendante relevant du droit commun. Le roi gardait sans doute le souvenir de la lutte des Parlements judiciaires contre la monarchie ; un combat se manifestant notamment par le refus d’enregistrements des édits royaux. Puis, la loi des 16-24 août 1790 et celle du 16 fructidor an III sont venues consacrer le droit administratif français, qui est essentiellement jurisprudentiel, prétorien, créateur d’un droit précurseur. Certains auteurs pensent que ce privilège de juridiction, accordée à l’administration, serait né d’un malentendu. Mais, depuis la loi du 24 mai 1872, lorsque le Conseil d’État statue au contentieux, c’est-à-dire comme juge de l’administration, il ne pratique plus la « justice retenue » qui conduisait ce juge à présenter au chef de l’exécutif son projet de décision pour signature : c’était l’époque du « ministre-juge ». Donc, depuis cette loi de 1872, le Conseil d’État est devenu une véritable juridiction dont l’indépendance est consacrée par deux décisions du Conseil constitutionnel rendues le 22 juillet 1980 et le 23 janvier 1987. Cette indépendance est qualifiée comme étant l’un des « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République » qui ont une valeur constitutionnelle. Mais, la survenue de la Covid-19, maladie liée au Sars-CoV-2, semble mettre en évidence la relativité de cette indépendance face aux réflexes autoritaires actuels de l’exécutif et du législateur.
L’intérêt de cette réflexion réside dans l’analyse de la position actuelle du Conseil d’État face aux actes réglementaires, tels que les décrets, qui ont été rendus par l’actuel gouvernement dans le cadre de l’obligation vaccinale contre la Covid-19.
Il y a lieu de s’interroger, notamment, sur l’ordonnance n°456571 qui a été rendue, le 27 septembre 2021, par le juge des référés du Conseil d’État. Cette décision fait suite à un recours en référé liberté (article L.521-2 du code de justice administrative) qui a été introduit par une avocate représentant des professionnels de santé soumis à cette obligation vaccinale contre la Covid-19. Ces requérantes ont présenté des éléments susceptibles de caractériser l’urgence et l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Mais, de façon laconique, ce juge de l’évidence rejette la demande de ces requérantes. Selon ce juge, ces citoyennes françaises ne peuvent se prévaloir ni de la caducité de l’autorisation de mise sur le marché (AMM) conditionnelle du vaccin contre la Covid-19 (I), ni de leur liberté fondamentale qui puise sa source dans leur consentement libre et éclairé (II). Une telle décision rappelle que le Conseil d’État est un arbitre qui ne juge pas toujours dans l’intérêt des patients et des deniers publics (III).
I. La caducité de l’AMM conditionnelle du vaccin : un argument inopérant selon le Conseil d’État
Les requérantes soutiennent que l’AMM du vaccin contre la Covid-19 est devenue « caduque » (A). Mais, le Conseil d’État considère qu’elles ne peuvent utilement se prévaloir de cet argument (B).
A. Une AMM conditionnelle « caduque » : un argument versé au débat contradictoire
Le juge des référés relève bien l’argument des requérantes selon lequel « le vaccin Pfizer ne peut plus être administré aux requérantes dès lors que son autorisation conditionnelle de mise sur le marché est caduque, en l’absence d’éléments établissant qu’une demande de renouvellement de cette autorisation a été présentée dans les délais prévus par les règlements européens applicables ». En effet, dès le 17 août 2021, le centre territorial d’information indépendante et d’avis pharmaceutiques (CTIAP) du centre hospitalier de Cholet s’est interrogé sur l’avenir des autorisations de mise sur le marché (AMM) « conditionnelles » octroyées aux quatre vaccins contre la Covid-19 : ceux des laboratoires BioNTech/Pfizer, Moderna, Astra Zeneca, Janssen. Ces AMM sont temporaires et leur durée n’excède pas un an. Ces vaccins sont toujours en phase III d’essai clinique, et sont donc expérimentaux (cf. article du CTIAP du 17 août 2021).
Mais, cette durée de validité n’est valable que si ces fabricants introduisent une demande de renouvellement de cette AMM six mois avant l’expiration de cette durée d’un an ; et l’agence européenne du médicament (EMA) a trois mois pour rendre son avis sur cette demande : cet avis doit être rendu public. Ces règles impératives sont consacrées par un règlement européen (n°507/2006 de la Commission du 29 mars 2006 relatif à l’autorisation de mise sur le marché conditionnelle de médicaments à usage humain relevant du règlement (CE) n°726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments). Interrogée sur cette validité de ces AMM, l’ANSM fournit deux réponses différentes (cf. article du CTIAP du 16 septembre 2021) ; et l’EMA semble confirmer l’absence d’éléments susceptibles de lever le doute sur cette validité de ces AMM conditionnelles (cf. article du CTIAP du 2 octobre 2021).
Cette caducité, soulevée lors du débat contradictoire, ne semble pas inquiéter le Conseil d’État.
B. Une AMM conditionnelle « caduque » : un argument ne pouvant être utilement invoqué selon le Conseil d’État
Dans sa décision, le juge des référés considère que « les requérantes ne sauraient utilement se prévaloir, à l’encontre des dispositions attaquées, des conditions de renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché conditionnelle délivrée pour l’un des vaccins contre la Covid-19 [Pfizer, en l’espèce] ». Le juge n’accompagne cette décision d’aucune motivation. D’ailleurs, dans son mémoire en réponse daté du 17 septembre 2021, le ministre des Solidarités et de la Santé ne répond pas à cet argument, pourtant versé au débat contradictoire. Devrait-on comprendre que la validité d’une AMM ne serait plus une condition préalable à la mise sur le marché d’un médicament (vaccin) alors même que ce produit est actuellement administré à des milliards de personnes humaines ?
Pourtant, cette AMM est pour le médicament ce qu’une carte grise représente pour une voiture. Sans cette autorisation administrative valable, un laboratoire pharmaceutique ne peut vendre un médicament. Le contrôle de la validité de cette autorisation administrative (cette AMM) relève de la compétence du juge administratif qui est le juge de la légalité. Ce dernier veille notamment au respect des procédures préalables à l’adoption de cette AMM et de son renouvellement. Il est compétent pour suspendre tout décret, notamment, qui se fonde sur cette AMM devenue caduque. Il doit veiller au respect de la hiérarchie des normes : ici, le règlement européen n°507/2006 de la Commission, ci-dessus mentionné, prime sur toute loi nationale ; et le juge doit écarter cette loi si celle-ci ne respecte pas le droit européen.
Et ce n’est pas tout. Le juge des référés prive les requérantes de leur consentement libre et éclairé qui est pourtant au rang d’une liberté fondamentale.
II. Le consentement libre et éclairé d’une personne humaine : un deuxième argument inopérant selon le Conseil d’État
Selon le juge des référés, le consentement libre et éclairé d’une personne humaine est totalement soumis à l’exécutif et au législateur (A) ainsi qu’aux listes administratives fixant les effets indésirables et les contre-indications potentiels (B).
A. Le consentement libre et éclairé : totalement soumis à l’exécutif et au législateur selon le Conseil d’État
Toujours dans cette décision, le juge des référés considère que « le droit du patient de donner son consentement libre et éclairé aux soins médicaux qui lui sont prodigués ne saurait être utilement invoqué à l’encontre des dispositions prises par le pouvoir réglementaire pour mettre en œuvre une obligation de vaccination établie par la loi pour lutter contre l’épidémie de Covid-19, dont le principe même écarte l’application de ce droit ». Manifestement, le juge ne semble pas informé de l’existence de notamment la « Note d’alerte » du Conseil scientifique en date du 20 août 2021 (actualisée le 25 août 2021) qui remet en cause le seul fondement, de nature scientifique, à l’origine de cette loi instaurant l’obligation vaccinale : un aveu qui admet que ces vaccins ne peuvent empêcher la transmission virale entre les personnes. Et, en une phrase, ce juge vient anéantir, non seulement la jurisprudence du Conseil d’État elle-même, mais également tout notre corpus juridique composé de textes nationaux (français), régionaux (européens) et internationaux : un système juridique irrigué par l’esprit du Code de Nuremberg. Pour ce juge, lorsque le gouvernement décide, en application d’une loi, d’imposer l’administration d’un vaccin aux Français, ces derniers ne peuvent contester cette obligation : ils devraient juste s’exécuter, totalement. Or, il y a lieu de rappeler ce qu’un président de section au Conseil d’État a récemment soutenu lors d’un discours, en date du 8 septembre 2021, tenu lors d’un colloque « Justice administrative et Constitution de 1958 » de l’université Paris II Panthéon-Assas : « En l’absence de précision législative, il est revenu à la jurisprudence de définir la liberté fondamentale que le référé liberté a vocation à garantir. Le Conseil d’État a retenu une approche large et autonome de la liberté fondamentale. La Constitution n’est pas sa seule source de référence. Les conventions internationales garantes des droits fondamentaux, et d’abord la Convention européenne des droits de l’homme, sont aussi des repères. Au-delà des textes, la jurisprudence a sa part d’autonomie, par exemple pour affirmer que le droit pour un patient en état d’exprimer sa volonté de consentir à un traitement médical a le caractère d’une liberté fondamentale » (16 août 2002, Mme Feuillatey). En effet, ledit consentement aux soins est fondé sur l’autonomie de la volonté de la personne, la clé de voûte du respect de la dignité de la personne humaine. Cette autorité de la volonté de la personne repose sur les principes d’inviolabilité et d’intégrité du corps humain, y compris après la mort.
En outre, ce consentement est renforcé dans certaines situations telles que celle relative à la recherche biomédicale, ce qui est le cas ici. La liste des textes protecteurs de ce consentement est longue. Ces textes écrasent littéralement aussi bien ladite loi que ledit pouvoir réglementaire, contestés ; et que ce juge des référés voudrait resacraliser au risque de nous propulser vers une époque révolue. Ce juge devrait au moins lire l’avis, en date du 20 juillet 2021, qui a été rendu par le Conseil d’État lui-même : cet avis n’a pas retenu les dispositions de cette obligation vaccinale (cf. notamment page 2 et points 34, 35 et 36 du rapport). Et dans sa décision rendue le 5 août 2021, le Conseil constitutionnel ne s’est pas prononcé sur cette obligation vaccinale. Par ailleurs, ce juge devrait prendre connaissance de l’article publié en 2021 dans la Revue des Droits et Libertés Fondamentaux (RDLF) - RDLF 2021 chron. n°20 - sous le titre « sur la licéité d'une obligation vaccinale anti-covid » ; une réflexion proposée par un professeur de droit public à l’Université. Ce professeur démontre « le caractère inédit des procédés vaccinaux utilisés ». Il soutient : « Le fait qu’il s’agisse d’une vaccination en phase expérimentale ne saurait donc faire de doute ». Il observe : « L’ensemble de ces informations suffisent à convaincre que la pandémie de covid-19 a conduit les autorités sanitaires à autoriser une expérimentation vaccinale à grande échelle inédite dans l’histoire de la médecine ». Et, il conclut que « le consentement libre et éclairé » constitue « un frein à l’expérimentation médicale » et « un obstacle à l’obligation vaccinale ». En cas de non-respect de cette obligation de recueil du consentement libre et éclairé, en pareilles circonstances, une sanction pénale est même prévue.
Et ce hiatus se poursuit lors de l’interprétation des données relatives aux effets indésirables déclarés en pharmacovigilance, et aux contre-indications potentiels.
B. Le consentement libre et éclairé : totalement soumis aux listes administratives fixant des effets indésirables et des contre-indications potentiels du vaccin selon le Conseil d’État
L’exécutif a décidé de limiter de façon restreinte, générale et absolue la liste des contre-indications. L’appréciation médicale de ces contre-indications, à l’échelle de l’individu, est interdite. Ce qui est inédit. Inédit, comme notamment ces autres incertitudes qui concernent la « qualité » de la « substance active » et des « excipients », du « procédé de fabrication », de la « reproductibilité des lots » commercialisés ; c’est-à-dire la qualité intrinsèque, la composition, le cœur même, de ces vaccins. D’ailleurs, sur ce point, des preuves complémentaires étaient également attendues aux échéances suivantes fixées dans un calendrier établi par les agences de régulation : janvier 2021, 31 mars 2021, avril 2021, juillet 2021 (pour le vaccin BioNTech/Pfizer) ; janvier 2021, avril 2021, juin 2021 (pour le vaccin Moderna) ; 5 mars 2021, 30 avril 2021 (pour le vaccin Astra Zeneca) ; 31 mars 2021, 15 août 2021 (pour le vaccin Janssen). Par ailleurs, les faits démontrent notamment que cette vaccination obligatoire utilise ces vaccins expérimentaux dont le rapport bénéfice/risque révèle des incertitudes. Cette liste des contre-indications, actuellement imposée de façon limitative, générale et absolue, par l’administration aux prescripteurs, ne peut donc être suffisamment connue. Les déclarations de pharmacovigilance pourraient même révéler un fait historique : une mortalité inédite observée après l’administration de ces vaccins (sans présumer de la certitude du lien de causalité) ; en rappelant que cette pharmacovigilance souffre de deux limites majeures : une méthode d’imputabilité ne pouvant affirmer la certitude du lien de causalité et une sous-notification des cas relativement importante. D’ailleurs, selon un témoignage écrit d’une personne se présentant comme étant un « membre du Comité Scientifique Permanent Pharmacovigilance de l’ANSM », cette ANSM n’aurait pas respecté la méthode qu’elle avait, elle-même, fixée dans le cadre de l’analyse des effets indésirables présumés liés aux vaccins contre la Covid-19 ; et pour cette raison, l’auteur de ce témoignage aurait « démissionné en juin » de ce comité (cf. article du CTIAP du 30 septembre 2021).
Mais, le juge des référés, lui, emprunte une autre interprétation. Aux requérantes, qui invoquent leur « droit au respect de la vie » qui est protégé par l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CESDH), il répond ceci : « Si les requérantes font valoir que la limitation des possibilités de contre-indications individuelles qui résulte des dispositions contestées porterait une atteinte potentielle à ce droit, compte tenu des risques révélés par les données de pharmacovigilance, de tels éléments ne sont pas de nature à caractériser un danger de cette nature [c’est-à-dire un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes créé par l’action ou la carence de l’autorité publique] ». La liste administrative des contre-indications, combinée au raisonnement de ce juge, suggère aux Français la règle suivante : il faudrait d’abord s’injecter ce vaccin avant de déduire les contre-indications individuelles potentielles ; et si un effet indésirable grave est constaté mais qu’il n’est plus « évolutif », la contre-indication n’est pas - plus - retenue comme dans le cas des myocardites et péricardites. C’est aussi l’occasion de révéler les arguments du ministre des Solidarités et de la Santé qui ont été produits lors de cette instance : « Le caractère limitatif de cette liste, qui est donc lui-même relatif puisqu’elle peut évoluer dans le temps en cas de découverte de nouvelles données admises par les autorités sanitaires compétentes, ne saurait être regardé comme illégal (…) Enfin, élargir la liste à « des motifs médicaux personnels » comme l’entendent les requérantes au motif que les vaccins contre la Covid-19 homologués par l’EMA seraient susceptibles d’entraîner des effets secondaires [indésirables] qui ne sont pas encore connus reviendrait à priver d’effet l’obligation vaccinale prévue par le législateur (…) On peut rappeler, plus généralement, que de nombreuses pathologies sont sous surveillance de l’ANSM notamment parce qu’il y a eu déclaration d’effets indésirables (signaux potentiels ou événements déjà sous surveillance). Cela n’en fait pas des contre-indications pour autant, ces signaux n’évoluant pas dans le temps et ne donnant lieu actuellement, ni à une action corrective, ni à une discussion sur une éventuelle contre-indication. En cas d’évolution des données scientifiques, cette position serait évidemment amenée à être réévaluée (…) ». Le ministre des Solidarités et de la Santé semble se réfugier derrière les décisions desdites « autorités sanitaires compétentes ». C’est ce même ministre qui a soutenu dans un message publié, le 9 juillet 2021 sur le réseau social Tweeter, ceci :
#Vaccination #COVID19 | Si vous avez des courbatures après le vaccin, pas d'inquiétude…c'est que vous avez trop pédalé !
— Olivier Véran (@olivierveran) July 9, 2021
Prenez rdv dès maintenant sur https://t.co/pHsC89Y4aK#tousvaccinestousproteges pic.twitter.com/DmTOfJiKsG
Une telle affirmation pourrait être regardée comme la négation de tout effet indésirable, même le plus bénin, susceptible d’être provoqué par ces vaccins contre la Covid-19. Or, en réalité, et selon le code de la santé publique, une prescription médicale se fonde sur les « données acquises de la science » qui sont, par nature, inconnues dans une phase expérimentale telle que celle observée avec ces vaccins contre la Covid-19. Une telle intrusion administrative prive d’effets le droit de toute personne à une information claire, loyale et appropriée portant sur notamment les risques prévisibles fréquents, ou graves même exceptionnels.
Mais, il appartenait au juge administratif d’intervenir pour mettre un terme à ce décret iatrogène. Ce qu’il n’a pas fait. Et une telle posture du Conseil d’État n’est pas entièrement nouvelle.
III. Le Conseil d’État : un arbitre ne jugeant pas toujours dans l’intérêt des patients et des deniers publics
Dans le domaine complexe du médicament, le Conseil d’État est compétent pour contrôler les dérives de l’administration (A). Mais parfois, il n’hésite pas à maintenir sur le marché des médicaments plus dangereux qu’utiles (B).
A. Le Conseil d’État : un juge censé contrôler les dérives de l’administration dans le domaine du médicament
Le Conseil d’État est le juge de la légalité. Cette notion de légalité s’inscrit dans le respect de la hiérarchie des normes en tenant compte de notamment la primauté et l’effet direct du droit européen. Et une fois cette légalité contrôlée, il vérifie la façon avec laquelle ces autorités administratives ont appliqué les critères de cette légalité aux faits. Autrement dit, le juge s’assure, d’abord, que ces autorités se sont fondées sur des faits matériellement exacts. Et, ensuite, il vérifie que ces autorités ont correctement apprécié ces faits. Il reste donc vigilant même s’il n’opère qu’un contrôle restreint eu égard à la technicité du domaine complexe du médicament. Le Conseil d’État est un arbitre important face à une administration qui a le privilège de pouvoir bénéficier de prérogatives « exorbitantes du droit commun » ; mais à la condition de voir l’action de cette administration poursuivre un but d’intérêt général.
Par exemple, le Conseil d’État a déjà pu juger que, eu égard au manque de précision des informations relatives au déroulement des essais portant sur la bioéquivalence entre un médicament générique et la spécialité d’origine, l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que cette bioéquivalence n’avait pas été démontrée de manière suffisamment fiable et qu’elle pouvait ainsi refuser la délivrance de l’autorisation de mise sur le marché sollicitée par le laboratoire pharmaceutique (CE, 23 juill. 2003, Société CLL Pharma, n°243926). Le Conseil d’État a même jugé que, compte tenu de la fréquence et de la gravité des effets indésirables d’un médicament, alors même qu’il permettrait une certaine amélioration de la médiane de survie globale des patients atteints d’un cancer métastatique du pancréas, le refus de l’inscrire sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation (CE, 12 mai 2010, Société Roche, n°316859). Du moins, ce contrôle restreint n’empêche pas le juge de convoquer ses pouvoirs d’instruction en faisant, par exemple, appel à une expertise indépendante.
Mais, le Conseil d’État semble parfois privilégier d’autres intérêts.
B. Le Conseil d’État : un juge n’hésitant pas à maintenir sur le marché des médicaments plus dangereux qu’utiles
En réalité, ce positionnement de la haute juridiction administrative n’est pas totalement surprenant eu égard au constat effectué notamment par la revue Prescrire dans un article paru en 2017 : « Les décisions du Conseil d’État ont un impact sur l’équilibre entre les intérêts économiques des firmes et les intérêts de la santé publique et des comptes sociaux. Dans plusieurs exemples au fil des années, cet impact n’a pas été dans l’intérêt des patients, quand le Conseil d’État a maintenu sur le marché des médicaments plus dangereux qu’utiles, ou leur remboursement par l’assurance maladie ». Le Conseil d’État s’arroge bien le droit de désavouer l’ANSM, qui est censée être le gendarme du médicament, face à des firmes pharmaceutiques en allant au-delà dudit contrôle de légalité. Par exemple, il a pu considérer que l’ANSM a commis une erreur manifeste d’appréciation en retirant l’AMM de KETUM® (Kétoprofène) gel en justifiant sa décision par « l’absence d’indices sérieux et concluants d’un risque grave pour la santé publique ». Il a aussi annulé le déremboursement de DERINOX® (naphazoline et prednisolone) alors que le bénéfice/risque de ce médicament est défavorable ; car il a estimé notamment que les ventes de « ce médicament représentent une part significative du chiffre d’affaires total de la société Thérabel Lucien Pharma ». Il a également différé de six mois le déremboursement de l’Olmésartan en motivant sa décision par notamment « la rareté du risque d’entéropathie associé au traitement ». Ce constat semble atteindre sa pleine dimension dans le cadre de cette obligation vaccinale contre la Covid-19 ; et du passe sanitaire qui fait appel également à des tests biologiques de diagnostic peu performants, non dénués de risques graves lorsqu’ils sont répétés, et coûteux.
De même, en 2013, le Conseil d’État a déjà pu valider un arrêté potentiellement dangereux pour les patients hospitalisés notamment. Cet arrêté a été contesté par un syndicat des pharmaciens auprès du Conseil d’État. Il s’agit de l’arrêté du 6 avril 2011 relatif au management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse et aux médicaments dans les établissements de santé. Un arrêté qui est venu semer davantage la confusion et « complexifier le paysage » selon l’inspection générale des affaires sociales. D’abord, cet arrêté introduit la notion contestée de « médicaments à risque » ; alors que tout médicament présente un risque d’effets indésirables. Mais, ses inventeurs étaient incapables de fournir une liste exhaustive de ces « médicaments à risque » et les modalités de la mise à jour en temps réel d’une telle liste. Ensuite, cet arrêté autorise le pharmacien hospitalier à n’effectuer qu’une analyse partielle de l’ordonnance médicale en limitant cette expertise à ces soi-disant médicaments à risque. Cet arrêté heurte le fondement même du métier premier du pharmacien tel qu’il est consacré par le code de la santé publique. En allégeant les obligations qui pèsent sur le pharmacien hospitalier, il a enfermé ce dernier dans l’illusion d’une pratique sécurisée ; les autres pharmaciens, eux, ne sont pas concernés par cet arrêté iatrogène. En fissurant l’indivisibilité du métier premier du pharmacien, ce texte réglementaire a instauré un schisme pharmaceutique, sous le regard du Conseil d’État.
Aujourd’hui, la gestion des vaccins contre la Covid-19 a donné naissance à une « affaire » inédite, et c’est peu dire. Mais, les Conseillers du Palais Royal, du moins certains d’entre eux qui ont eu à connaître plusieurs aspects de cette affaire, n’ont pas encore décidé de sonner le glas en rappelant notamment les conditions d’une obligation vaccinale : intérêt (protection) pour autrui ; rapport bénéfice/risque favorable du vaccin démontré par des preuves vérifiables, de bonne qualité et sur une durée d’évaluation suffisante (de dix ans minimum) ; utilité ; stricte proportionnalité et nécessité par rapport à l’objectif poursuivi (ici, lutte contre la propagation de l’épidémie). C’est une nouvelle occasion manquée, par le Conseil d’État, qui place des citoyens français dans une position vulnérable face à des réflexes autoritaires qui voudraient s’approprier le corps de chaque personne humaine.
Et « ton corps appartient à la nation, ton devoir est de veiller sur toi-même » (Extrait des 10 commandements de la santé… des jeunesses Hitlériennes (1939). Cité par J. ATTALI, l’Ordre cannibale, 1979).
Le Dr Amine Umlil est docteur en pharmacie et juriste.
À LIRE AUSSI

L'article vous a plu ? Il a mobilisé notre rédaction qui ne vit que de vos dons.
L'information a un coût, d'autant plus que la concurrence des rédactions subventionnées impose un surcroît de rigueur et de professionnalisme.
Avec votre soutien, France-Soir continuera à proposer ses articles gratuitement car nous pensons que tout le monde doit avoir accès à une information libre et indépendante pour se forger sa propre opinion.
Vous êtes la condition sine qua non à notre existence, soutenez-nous pour que France-Soir demeure le média français qui fait s’exprimer les plus légitimes.
Si vous le pouvez, soutenez-nous mensuellement, à partir de seulement 1€. Votre impact en faveur d’une presse libre n’en sera que plus fort. Merci.